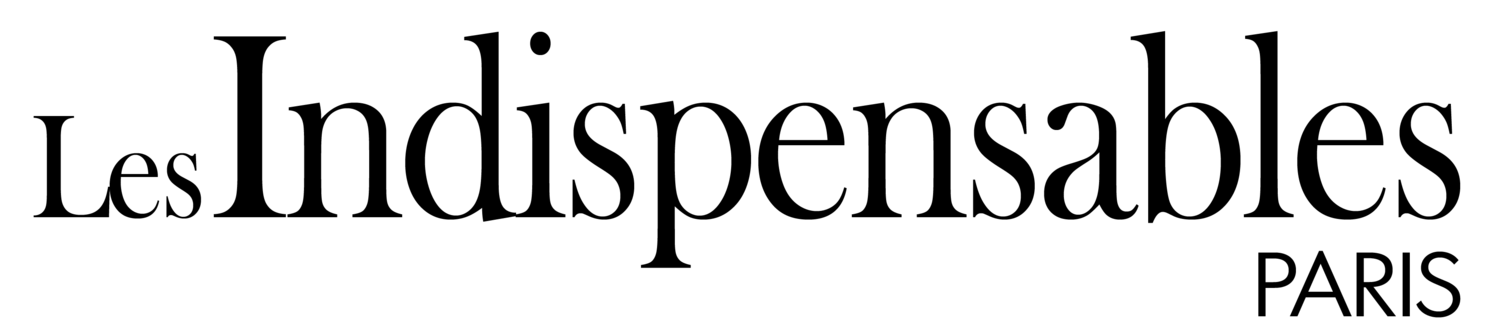Anthony Delos
/« La folie, c’est continuer à faire la même chose en attendant un résultat différent. » Cette définition, souvent attribuée à Albert Einstein, me semble un peu réductrice.
Par exemple, si vous demandiez à mes parents en 2011, la folie c’était leur fils étudiant qui vidait ses économies pour se faire réaliser une paire de chaussures sur mesure.
J’eu beau leur expliquer que ce n’étaient pas des chaussures mais des souliers, enfin, plus précisément des richelieus perforés à découpe balmoral, bout droit fleuri, talon légèrement cubain, lisse collante en cambrure interne et externe, double queue de chien (pour le délire) et couture des garants en col de cygne (pour un peu de coquetterie), rien n’y fit. Même l’argument d’autorité échouait : à l’évocation du nom d’Anthony Delos, le regard de mes parents trahissait toujours l’incompréhension et l’inquiétude. Leur fils était-il perdu ? (Spoiler : oui.)
À cette époque, la renommée Anthony Delos était à son apogée. Après son tour de France, le compagnon du devoir avait passé plusieurs années à la mesure de Lobb Paris avant de s’installer à son compte en 2004, dans un premier atelier situé rue Constance à Montmartre. Vous y trouverez aujourd’hui encore une excellente cordonnerie. Entre 2004 et 2011, Anthony a acquis une solide réputation auprès d’une clientèle française et internationale d'aficionados de la botterie et autres obsédés du cousu trépointe.
Pour nos rares lecteurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de faire appel aux services d’un bottier, l’opération se déroule en plusieurs étapes espacées de quelques mois, voire davantage selon l’artisan et sa « bande passante » (pour reprendre la novlangue de l’open-space).
Lors de notre premier rendez-vous, Anthony avait déjà déménagé son atelier aux Rosiers-sur-Loire et recevait ses clients dans une showroom de la rue Volta, très justement situé dans le quartier des Arts et Métiers. Cette rencontre est généralement l’occasion pour l’artisan et le client de faire connaissance, de se mettre d’accord sur un modèle et une forme, les détails pouvant être ajustés en cours de processus. S’en suit, bien évidemment, la cérémonie de la prise de mesures.
J’étais arrivé avec quelques idées de patronage en tête, dont certaines un peu trop extravagantes, Anthony avait su me guider avec patience et bienveillance. Une fois les idées claires sur le modèle, la peausserie et le montage, Anthony dégaina son mètre ruban, son crayon et se lança dans la prise de mesure de mes pieds. Bien entendu, j’avais anticipé et apporté un soin encore plus particulier au choix de mes chaussettes ce matin là.
Après quelques mois, vint le premier essayage. Je n’ai pas retrouvé de photo (j’ai pourtant le souvenir d’en avoir publié sur facebook à l’époque…) mais imaginez vous une paire d’essayage avec une semelle en liège, charcutée au tranchet pour s’assurer de la justesse du chaussant.
Quelques mois encore et arrivait la veille de mon anniversaire. Ce jour là, Anthony me remettait enfin la paire finale. Je dénouais les cordons des pochons de coton blanc épais et constatais la finesse du travail qui avait fait la réputation du maître. Une réalisation irréprochable et une précision chirurgicale. Au pied, la sensation unique d’un soulier au maintien étonnamment rigide, pourtant souple quand le pied se plie pendant la marche.
Difficile d’exprimer ce que j’ai ressenti à ce moment là. Dans un film cela aurait correspondu à des gros plans au ralenti sur un air du Duo des Fleurs de Lakmé (mais si, vous le connaissez). J’ai probablement entendu la musique dans ma tête. Il faut dire que mon impatience avait été particulièrement attisée par la nouvelle, quelques semaines plus tôt, qu’Anthony avait remporté le concours de meilleur ouvrier de France…
Après ce moment suspendu, la vie reprenait son cours : derniers stages, derniers examens, premiers entretiens d’embauche… Mes Delos m’ont accompagné tout au long de ces étapes. Beau soleil ou jours de pluie. Flânerie débonnaire sur les pavés ou sprint dans les escalators du métro. Apéritif estival sur les quais de Seine ou évaluation professionnelle annuelle.
Mais la vie, contrairement à un flan, se démoule rarement sans accrocs. Heureusement, un bon coup de cirage et les accrocs se fondent harmonieusement dans la peausserie. C’est ainsi que le temps honore d’une patine unique les beaux souliers et ceux qui les portent.
Parmi les illusions dont se bercent les amateurs de souliers, il n’est pas rare d’entendre qu’une bonne paire bien entretenue peut durer une dizaine d’année, voire toute une vie (surtout quand on dispose d’une flotte de chaussures qui permet une rotation à un rythme pianissime). Mais cette longévité proverbiale doit être tempérée par la nécessité de procéder à un occasionnel changement de patins, voire à un ressemelage. En ce qui nous concerne, le besoin de ressemeler s’est fait sentir en 2018. Moins de dix ans donc, mais pour une paire qui n’a pas été particulièrement ménagée et dont le cuir des semelles n’a jamais été recouvert par des patins de caoutchouc, la performance est honorable.
Bien entendu, on ne confie pas le ressemelage d’une paire sur mesure à n’importe qui. Après quelques hésitations, un peu de tergiversations, et beaucoup de procrastination, j’ai finalement pris attache avec Anthony l’année dernière. Il m’a confirmé que son atelier assurait toujours le SAV malgré son rachat par Berluti, en 2012. Ce qui était une bonne nouvelle car, en plus de son savoir-faire, l’atelier avait conservé tout le parc des formes qui y sont nées. Mes souliers ont ainsi pu être remontés sur leurs formes d’origine, et retrouver leur ligne de 2011 (ah, si seulement ça pouvait être aussi facile pour tout le monde…).
Je vous laisserai juger des photos (qui datent, vous m’excuserez, j’ai été un peu occupé) de la réception des richelieus ressemelés, mais je les trouve encore plus beaux qu’avant.
Je ne serais pas complètement honnête avec vous si je ne partageais pas l’épilogue, un peu amer, de cette belle histoire. Après une journée entière de souffrance, je dois me rendre à l’évidence, la morphologie de mes pieds a trop changé pour que les plus beaux souliers qu’il m’ait été donné de porter restent confortables. C’est un peu triste, mais ne dit on pas qu’il vaut mieux avoir perdu l’amour que ne jamais avoir aimé ? Et puis, c’est un très bon prétexte pour s’acheter de nouvelles chaussures, mais je vous en parlerai dans un prochain article...